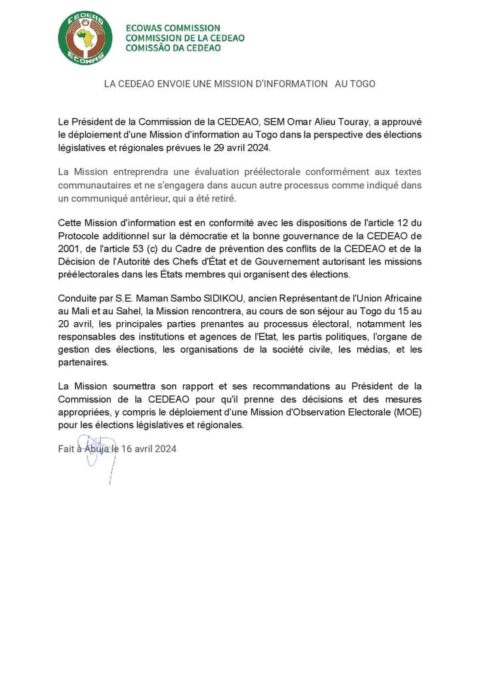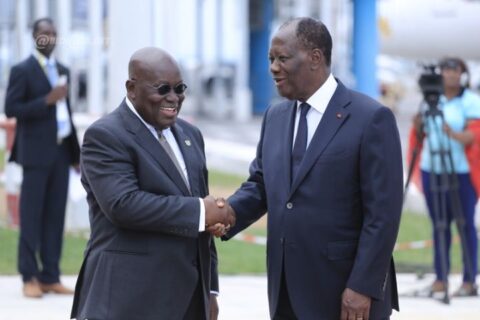Adoptée à la majorité par la Chambre des Conseillers après plusieurs mois de reports, la réforme du code de procédure pénale au Maroc fait l’objet d’une vive controverse. Présenté par le ministère de la Justice comme un pas vers la modernisation du système judiciaire, le texte est largement critiqué par une partie de la société civile, des avocats et des partis d’opposition.
Le gouvernement met en avant un renforcement de l’encadrement de la garde à vue, une meilleure coordination entre les différents acteurs judiciaires – police, parquet, juge d’instruction – et une volonté de modernisation procédurale. Mais cette réforme, loin de faire consensus, est accusée d’opérer un recul inquiétant dans la lutte contre la corruption.
Deux articles en particulier, les articles 3 et 7, concentrent les critiques. Ils limitent drastiquement la capacité des associations à se constituer partie civile dans les dossiers de corruption, à moins d’obtenir une autorisation expresse du ministère de la Justice. En l’absence de cette autorisation, seul le procureur général près la Cour de cassation pourra initier de telles procédures. Un verrou jugé inquiétant, dans un pays où les affaires de corruption sont fréquentes et rarement sanctionnées.

Pour l’avocate Kawtar Jalal, cette réforme marque un tournant préoccupant : « S’agit-il d’une modernisation technique ou d’une recentralisation autoritaire ? », s’interroge-t-elle publiquement. À ses yeux, ces dispositions contredisent l’esprit de la Convention des Nations unies contre la corruption, qui encourage l’implication des citoyens et des organisations dans la lutte anticorruption.
Le Maroc, qui a perdu 26 places depuis 2018 dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International (99e sur 180 en 2024), est ainsi accusé d’éloigner la société civile d’un domaine clé de la transparence publique. Les ONG redoutent qu’en restreignant les contre-pouvoirs, cette réforme ouvre la voie à une justice moins indépendante et à un climat d’impunité renforcé.