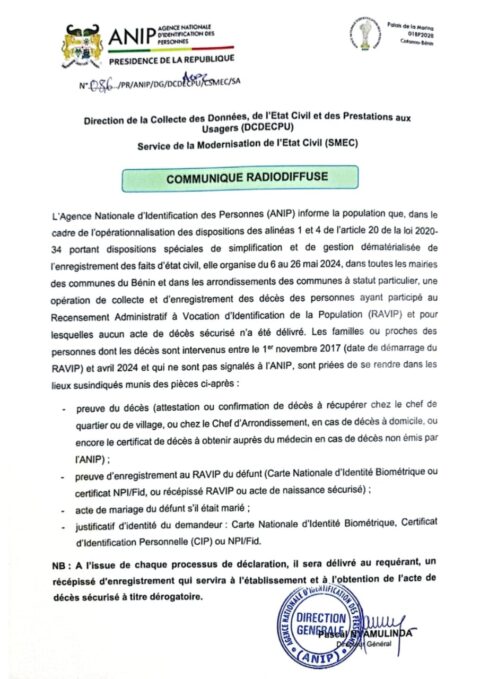Le général Abdourahamane Tiani, président de la transition militaire au Niger, a choisi de camper sa posture stratégique sur un point de friction diplomatique : la frontière bénino-nigérienne. Dans un entretien télévisé très attendu, il a justifié la poursuite de sa fermeture en invoquant la menace sécuritaire que représenterait, selon lui, la coopération entre le Bénin et la France. Pour les observateurs extérieurs, cette déclaration relève moins de la sécurité régionale que d’un exercice d’enfumage politique. Car derrière le ton martial, se cache une profonde dissonance : le Niger s’enfonce dans l’instabilité, pendant que ses dirigeants regardent ailleurs.
Une rhétorique bien rodée
Depuis son coup d’État de juillet 2023, Tiani s’est taillé une réputation de tribun du ressentiment postcolonial. Dans ses discours, la France est omniprésente — source de tous les maux, cerveau présumé de toutes les conspirations. Le Bénin, voisin du sud-ouest, n’est désormais plus un simple partenaire régional : il est décrit comme un avant-poste de la « déstabilisation » orchestrée par l’ancienne puissance coloniale.
Et pourtant, derrière ces postures, peu de faits solides. Ni preuve matérielle, ni démonstration diplomatique, ni rapport d’enquête indépendant. Juste des allégations graves, répétées avec aplomb dans des entretiens verrouillés, où l’on sent davantage le souci de soigner une image de fermeté que de convaincre sur le fond.
Tiani accuse Cotonou de « duplicité », reproche au président Patrice Talon d’ignorer les alertes de Niamey, et réclame implicitement un alignement stratégique : pour que la frontière rouvre, le Bénin devrait, en somme, renoncer à sa souveraineté en matière de défense. Depuis quand un État africain doit-il ajuster sa politique extérieure aux desiderata d’un régime militaire voisin ?
Le paradoxe sécuritaire
Dans le même entretien, le général nigérien affirme avoir infiltré les réseaux terroristes opérant dans le Sahel — notamment l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS). Il affirme disposer de « sources internes » qui lui rapportent les réunions, les mouvements et les dynamiques entre groupes armés.
Un exploit ? Une opération de renseignement d’envergure ? Peut-être. Mais alors une question s’impose : à quoi bon disposer de telles informations si l’on ne parvient pas à éviter la multiplication des attaques sur son propre sol ?
Rien qu’en mai 2025, le Niger a connu une série noire :
• 58 soldats tués à Eknewen (Tahoua) le 24 mai,
• 53 autres à Boumba-Falmey (le long du fleuve Niger) deux jours plus tard ,
• Des dizaines d’autres morts à Tahoua, Dosso, Fantio, Diffa.
La liste est longue, tragique, et quasiment ignorée dans le discours présidentiel. Aucune stratégie de sortie de crise. Aucun aveu d’échec. Juste des accusations externes.
Une obsession qui affaiblit la coopération régionale
En ciblant ainsi le Bénin, le général Tiani nuit à un principe fondamental de la sécurité sahélienne : la coopération transfrontalière. Les flux de menaces — groupes armés, trafics, radicalisation — ignorent les frontières administratives. Or la stabilité de la région dépend de la capacité des États à travailler ensemble, quel que soit leur régime politique.
Rompre cette chaîne de coopération au nom d’une querelle diplomatique, c’est fragiliser toute l’architecture sécuritaire de l’Afrique de l’Ouest. Le Niger s’était pourtant imposé, sous Mahamadou Issoufou puis Mohamed Bazoum, comme un partenaire fiable. Aujourd’hui, il s’enfonce dans l’isolement, verrouille son espace médiatique, et ferme ses portes à ses voisins tout en tendant la main à d’autres puissances (notamment la Russie) dans une logique de substitution plus idéologique que pragmatique.
Une sortie de crise par le bas
Les accusations portées contre la France, le Bénin, le Nigeria et même la Croix-Rouge internationale — soupçonnée sans preuves de financer des groupes armés — trahissent une tentation dangereuse : celle de redessiner le récit régional à coup de complots. On appelle cela la stratégie du déni. Une méthode éprouvée par certains régimes autoritaires : faire diversion, transformer l’échec en trahison, réécrire la réalité pour dissimuler les impasses .
Mais la communauté internationale, les partenaires africains et les citoyens nigériens eux-mêmes méritent mieux. L’heure est à la transparence, au dialogue, et à la coopération intelligente — pas aux procès d’intention et à la fermeture obstinée.
Un dernier mot : l’Afrique est plurielle
Le Niger a choisi sa voie. Le Bénin a choisi la sienne. Aucun pays africain n’a vocation à imposer sa trajectoire aux autres. La souveraineté n’est pas une variable à géométrie militaire. Elle est le droit fondamental de chaque peuple à définir ses priorités, ses alliances et ses choix stratégiques. Et cela vaut autant pour Niamey que pour Cotonou.
À l’heure où les défis sahéliens exigent unité, lucidité et efficacité, persister dans les querelles idéologiques revient à abandonner le terrain aux groupes armés. Et cela, ni le Bénin, ni le Niger, ni aucun pays de la sous-région ne peut se le permettre .